
L'homme dans l'univers
Par Dominique Lambert (Docteur en physique, docteur en philosophie)
 |
Science
et Foi L'homme dans l'univers Par Dominique Lambert (Docteur en physique, docteur en philosophie) |
| Dans le dossier de ce mois, nous allons évoquer les relations entre science et foi à travers deux exemples. Les origines du monde nous amèneront à étudier les liens entre la foi, la physique et la cosmologie modernes. Les origines de l’homme et l’évolution nous permettront de confronter ce que disent la foi et la biologie. |
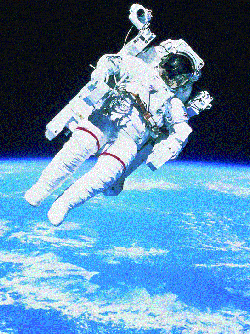 Durant toute
sa vie, le grand mathématicien belge Monseigneur Georges Lemaître
(1894-1966) a défendu une sage position concernant les rapports entre
la science et la foi, en affirmant la nécessité de ne pas utiliser
directement les sciences à des fins théologiques. Pour Mgr Lemaître,
Président de l’Académie Pontificale des Sciences (1960-66) et
l’un des principaux initiateurs de la théorie du Big Bang, le commencement
“naturel” de l’univers (cet état très chaud et très concentré
dans lequel, il y a plus ou moins 15 milliards d’années, se trouvait
réduit notre univers) ne pouvait en aucun cas être confondu avec
la création au sens théologique. Inutile, nous a-t-il appris,
d’aller scruter cet état pour “voir le doigt de Dieu”, pour appréhender
son acte créateur. En effet, cela aurait aussi peu de sens que d’aller
explorer le cosmos avec une navette spatiale perfectionnée pour voir
dans quelle galaxie Dieu se cache ou d’espérer trouver l’âme au
bout d’un scalpel ou en utilisant un scanner. Mgr Lemaître avait une foi
très profonde, il appartenait d’ailleurs à une fraternité
de prêtres (“Fraternité Sacerdotale des Amis de Jésus” fondée
par le cardinal Mercier) dont la structure et les exigences spirituelles rappellent,
à beaucoup d’égards, celles que l’on trouve aujourd’hui dans les
nouvelles communautés (vie de prière intense, réunions
en communauté locales et régionales, accompagnement personnel,…).
Par respect pour cette foi, il refusait de mettre au même niveau (comme
on le fait dans la gnose ou dans le Nouvel Âge) la richesse des vérités
théologiques et les hypothèses scientifiques. Il avait d’ailleurs
coutume de dire : « J’ai trop de respect pour Dieu pour n’en faire qu’une
hypothèse (scientifique). » De plus, son honnêteté
intellectuelle lui faisait refuser de “trafiquer” les données scientifiques
pour en extraire comme de force quelques informations théologiques. Il
savait, à la suite de saint Thomas d’Aquin, qu’une défense de
la foi basée sur des arguments boiteux risque un jour ou l’autre de se
retourner contre la foi. Cette honnêteté intellectuelle a été
pour bon nombre de scientifiques de haut niveau un témoignage inestimable
et l’image du croyant et du prêtre s’en est trouvé grandie alors
qu’elle aurait été ridiculisée par une utilisation apologétique
directe de la théorie du Big Bang. Il faut le dire ici de manière
claire : la science n’apporte aucune preuve de l’existence de Dieu ni de celle
d’aucun niveau qui transcenderait l’ordre matériel. Par méthode,
la science ne nous donne accès qu’à la description des phénomènes
empiriques (que dirait-on aujourd’hui d’un astronome qui, à l’instar
de Newton autrefois, utiliserait l’idée d’une intervention directe de
Dieu pour assurer la stabilité des orbites des planètes ou celle
d’un “ange attracteur” pour expliquer pourquoi les corps célestes en
attirent d’autres ?).
Durant toute
sa vie, le grand mathématicien belge Monseigneur Georges Lemaître
(1894-1966) a défendu une sage position concernant les rapports entre
la science et la foi, en affirmant la nécessité de ne pas utiliser
directement les sciences à des fins théologiques. Pour Mgr Lemaître,
Président de l’Académie Pontificale des Sciences (1960-66) et
l’un des principaux initiateurs de la théorie du Big Bang, le commencement
“naturel” de l’univers (cet état très chaud et très concentré
dans lequel, il y a plus ou moins 15 milliards d’années, se trouvait
réduit notre univers) ne pouvait en aucun cas être confondu avec
la création au sens théologique. Inutile, nous a-t-il appris,
d’aller scruter cet état pour “voir le doigt de Dieu”, pour appréhender
son acte créateur. En effet, cela aurait aussi peu de sens que d’aller
explorer le cosmos avec une navette spatiale perfectionnée pour voir
dans quelle galaxie Dieu se cache ou d’espérer trouver l’âme au
bout d’un scalpel ou en utilisant un scanner. Mgr Lemaître avait une foi
très profonde, il appartenait d’ailleurs à une fraternité
de prêtres (“Fraternité Sacerdotale des Amis de Jésus” fondée
par le cardinal Mercier) dont la structure et les exigences spirituelles rappellent,
à beaucoup d’égards, celles que l’on trouve aujourd’hui dans les
nouvelles communautés (vie de prière intense, réunions
en communauté locales et régionales, accompagnement personnel,…).
Par respect pour cette foi, il refusait de mettre au même niveau (comme
on le fait dans la gnose ou dans le Nouvel Âge) la richesse des vérités
théologiques et les hypothèses scientifiques. Il avait d’ailleurs
coutume de dire : « J’ai trop de respect pour Dieu pour n’en faire qu’une
hypothèse (scientifique). » De plus, son honnêteté
intellectuelle lui faisait refuser de “trafiquer” les données scientifiques
pour en extraire comme de force quelques informations théologiques. Il
savait, à la suite de saint Thomas d’Aquin, qu’une défense de
la foi basée sur des arguments boiteux risque un jour ou l’autre de se
retourner contre la foi. Cette honnêteté intellectuelle a été
pour bon nombre de scientifiques de haut niveau un témoignage inestimable
et l’image du croyant et du prêtre s’en est trouvé grandie alors
qu’elle aurait été ridiculisée par une utilisation apologétique
directe de la théorie du Big Bang. Il faut le dire ici de manière
claire : la science n’apporte aucune preuve de l’existence de Dieu ni de celle
d’aucun niveau qui transcenderait l’ordre matériel. Par méthode,
la science ne nous donne accès qu’à la description des phénomènes
empiriques (que dirait-on aujourd’hui d’un astronome qui, à l’instar
de Newton autrefois, utiliserait l’idée d’une intervention directe de
Dieu pour assurer la stabilité des orbites des planètes ou celle
d’un “ange attracteur” pour expliquer pourquoi les corps célestes en
attirent d’autres ?).
|
Le travail capital qui incombe aux intellectuels catholiques consiste à dégager des interprétations philosophiques qui, tout en respectant l’acquis de leurs disciplines, restent compatibles avec cette ouverture à la transcendance que nous indique la Révélation. |
N’y aurait-il alors aucun contact entre le travail des scientifiques et celui des théologiens ? Si, bien entendu, mais cela n’est pas immédiat. Ce point de contact doit résulter d’un travail d’interprétation des vérités scientifiques, compatible avec celle qui nous est transmise par l’Église. C’est d’ailleurs comme cela que le Saint-Père a récemment balisé le problème des rapports entre sciences et foi dans le domaine de la biologie de l’évolution lors d’un discours à l’Académie Pontificale des Sciences. Prenons un exemple. Si nous étudions l’évolution humaine au niveau de la biologie, nous ne verrons jamais comme telle la “création de l’âme”, nous ne trouverons que des indices montrant des différences avec certains primates supérieurs, … Pas question d’aller faire intervenir l’âme pour expliquer les propriétés de certains fossiles. Mais, pour un catholique, toutes les interprétations (philosophiques) compatibles avec les données des sciences ne sont pas acceptables. En effet, celle qui prétendrait, se basant sur la continuité biologique entre l’homme et l’animal, qu’il n’existe pas de véritable transcendance métaphysique de l’être humain serait à rejeter puisque nous croyons dans la foi que seul l’homme a été fait à l’image de Dieu et est appelé à une relation intime avec son créateur. De la même manière, si les physiciens montraient que l’univers est explicable sans faire usage de la notion de commencement temporel (autrement dit sans Big Bang, comme chez Hawking ou Prigogine) cela n’autoriserait pas les scientifiques catholiques à accepter l’éternité du monde. En effet, passer d’un temps physique (mesurable et calculable) et de ses propriétés (commencement, fin) à une notion métaphysique d’éternité relève non pas de la science seule mais d’une démarche philosophique où toutes les interprétations ne sont plus recevables. La science donne un point de vue sur la réalité (ce point de vue doit être respecté, sous peine d’être malhonnête intellectuellement). Cependant, sans jamais être en contradiction avec la foi, celui-ci n’épuise pas la totalité des approches de la réalité. Le croyant sait dans la foi qu’il y a un autre regard sur l’homme et le cosmos qui vient compléter celui des sciences et lui donner sa vraie consistance. Le travail capital qui incombe aux intellectuels catholiques consiste à dégager des interprétations philosophiques qui, tout en respectant l’acquis de leurs disciplines, restent compatibles avec cette ouverture à la transcendance que nous indique la Révélation. Ce travail est d’autant plus urgent que remontent à la surface, en cette fin de siècle, tout à la fois un néo-positivisme négateur de toute transcendance (l’homme n’est qu’un paquet de molécules en interaction, la réalité matérielle est la totalité de ce qui existe,…) et une fausse mystique gnostique croyant faire dériver la transcendance de la seule considération des réalités immanentes (Dieu est un grand attracteur, Dieu est l’énergie du cosmos, la physique permet d’entrer dans les pensées de Dieu, …).
|
La description des phénomènes que nous livrent les sciences contemporaines peut devenir une occasion d’action de grâce pour la beauté et l’intelligibilité de la Création. |
Si le travail d’interprétation dont nous venons de parler
a été correctement mené alors les sciences peuvent devenir,
pour nous croyants, une occasion de rendre grâce au Créateur pour
toutes les merveilles qu’Il nous a offertes. Un sujet d’émerveillement
est la profonde unité des réalités qui peuplent l’univers.
Toute la réalité matérielle est, par exemple, construite,
des étoiles jusqu’à l’homme, des mêmes particules élémentaires
(quarks et leptons et les “messagers d’interaction” qui les lient). Toute la
réalité biologique, du brin d’herbe jusqu’à vous, fonctionne
à partir d’un même mécanisme génétique fondé
sur l’ADN. Toute la physique de l’univers est décrite par un nombre assez
restreint d’équations qui le rend étonnamment intelligible, …Ceci
n’est pas directement une preuve de l’existence d’un Créateur, mais si
nous croyons en Dieu, nous pouvons légitimement interpréter cette
unité comme le signe d’une harmonie profonde de la Création, comme
la trace d’une intelligence créatrice qui toute discrète n’en
reste pas moins saisissable avec le regard conjoint de l’intelligence et de
la foi. Aujourd’hui, les scientifiques découvrent que l’univers est très
particulier : en effet, ses caractéristiques (âge, dimensions,
intensité des forces,…) semblent être ajustées finement
pour permettre à la vie et à l’homme d’apparaître et de
se développer.(1) L’ajustement pourrait
résulter du hasard, mais le regard du croyant y voit comme la trace de
la volonté créatrice de préparer et adapter la Création
à l’homme, son image et son enfant. Plus encore que le ciel étoilé
d’une belle nuit d’hiver, la description des phénomènes que nous
livrent les sciences contemporaines peut devenir une occasion d’action de grâce
pour la beauté et l’intelligibilité de la Création. L’important
ici est que la contemplation du créé ne prenne pas le pas sur
celle du Créateur. On évitera ce travers en n’absolutisant jamais
le savoir scientifique (qui évolue historiquement et qui reste un savoir
simplement humain) et en révisant sans cesse le travail d’interprétation
qui repense toujours “à nouveaux frais” et sous le regard de la Révélation
les acquis de la raison. À ces conditions, nous saisirons un peu mieux
cette magnifique parole du psalmiste : « Les cieux racontent la gloire
de Dieu… ». ![]()
Ce texte est issu du numéro 142 de la revue Il est Vivant!